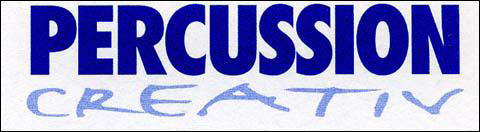Rezension Diapason Septembre 2002 | Jean-Charles Hoffele | 1. September 2002 Deutsche Gramophon ne permit pas à Kubelik d’enregistrer « Le Chant de la...
Deutsche Gramophon ne permit pas à Kubelik d’enregistrer « Le Chant de la terre », qui aurait constitué le point d’orgue de son cycle Mahler ; la firme hambourgeoise avait confié l’œuvre en 1962 à Jochum (sa seule gravure mahlérienne) et au Concertgebouw, avec Merriman et Haefliger. Dans ce concert de février 1970, Kubelik, selon un parti pris qu’il soutint tout au long de son intégrale, refuse tout pathos, tout morbidité ; il expose la partition en pleine lumière, radiographiant les mises en abyme de l’orchestre mahlérien avec une précision expressive qui donne le vertige. A ce titre, le vaste interlude du lied ultime est exemplaire par sa parfaite limpidité ; l’émotion qu’il dégage ne provient pas d’une surcharge d’affect (comme chez Bernstein ou Walter) mais d’un regard lucide, implacable et néanmoins compatissant.
Porté par cet orchestre éclairé, l’alto de Baker ose un chant rayonnant, débarrassé de toute tentation d’assombrir le timbre (ce qu’elle réussissait admirablement avec Haitink, Philips), magnifié par une petite harmonie et des violons tenus par la direction sostenuto de Kubelik, qui semble omniprésente dans toutes les pupitres de l’orchestre, à tous les instants, distillant une immense musique du chambre. Kmentt, en grande voix, tranchant, héroïque, impressionne durablement et ne pâlit ni devant la beauté absolue de Wunderlich ni devant le « sprechgesang » enflammé de Patzak. Dans la plénitude de son geste, Kubelik entend « Le Chant de la terre » comme une partition ouverture sur l’avenir, tournant les dos aux vastes thrènes funèbres des grandes versions de l’œuvre, sentimentaux et étreignant (Walter, Bernstein, Haitink), minéraux et tragiques (Reiner, Klemperer). Il renouvelle totalement notre vision d’une partition-clé du début du siècle.
Porté par cet orchestre éclairé, l’alto de Baker ose un chant rayonnant, débarrassé de toute tentation d’assombrir le timbre (ce qu’elle réussissait admirablement avec Haitink, Philips), magnifié par une petite harmonie et des violons tenus par la direction sostenuto de Kubelik, qui semble omniprésente dans toutes les pupitres de l’orchestre, à tous les instants, distillant une immense musique du chambre. Kmentt, en grande voix, tranchant, héroïque, impressionne durablement et ne pâlit ni devant la beauté absolue de Wunderlich ni devant le « sprechgesang » enflammé de Patzak. Dans la plénitude de son geste, Kubelik entend « Le Chant de la terre » comme une partition ouverture sur l’avenir, tournant les dos aux vastes thrènes funèbres des grandes versions de l’œuvre, sentimentaux et étreignant (Walter, Bernstein, Haitink), minéraux et tragiques (Reiner, Klemperer). Il renouvelle totalement notre vision d’une partition-clé du début du siècle.